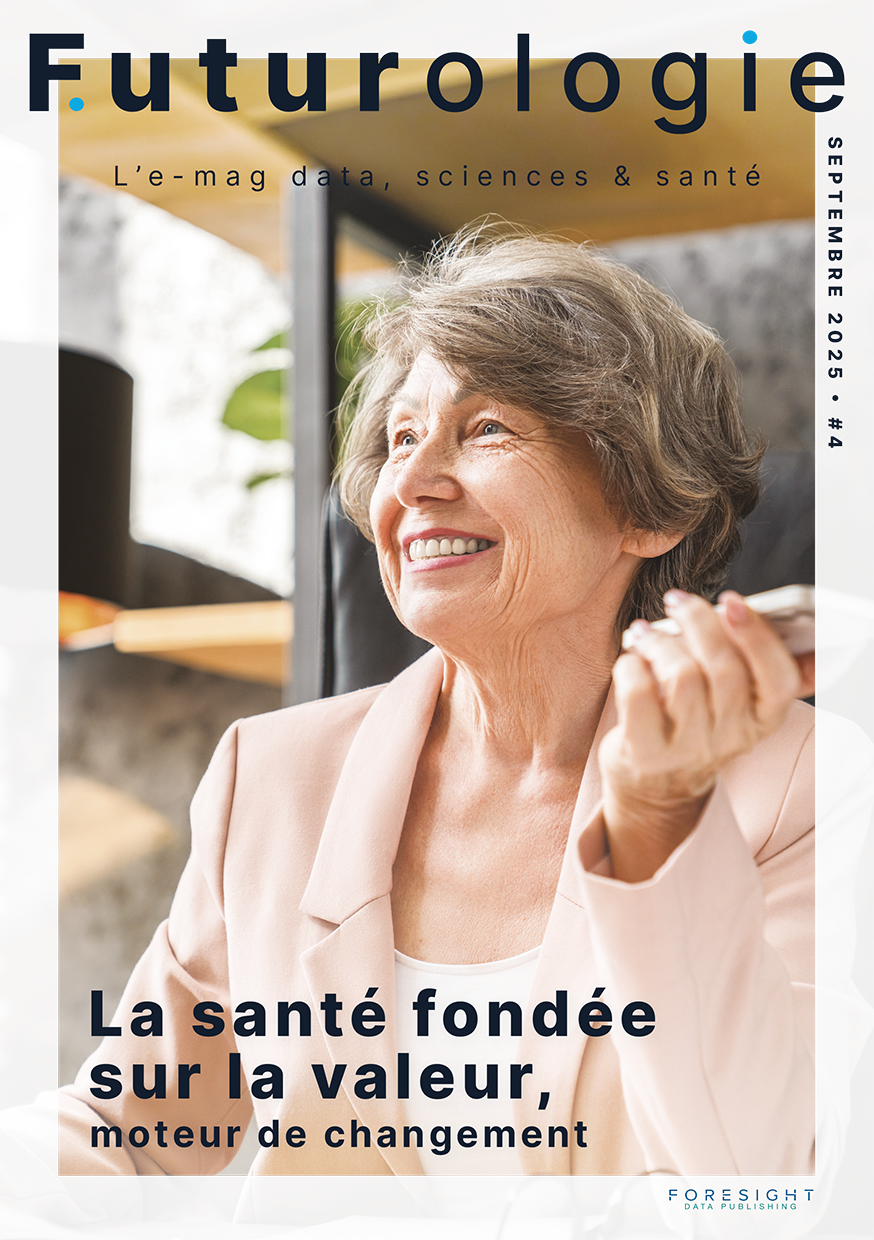Anne Buisson, directrice de l’AFA Crohn RCH France, seule association nationale de patients consacrée aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), milite pour une transformation du système de santé centrée sur les besoins réels des patients. À travers des travaux novateurs, une recherche qualitative rigoureuse et un engagement constant pour la reconnaissance du vécu des malades, elle porte une vision ambitieuse de la Value-Based Healthcare. Un modèle où la qualité des soins se mesure avant tout à leur pertinence du point de vue des personnes qui les vivent.
Mesurer la qualité des soins : les patients comme boussole
Anne Buisson pose les fondations de son engagement : ce changement de perspective est central dans les démarches que l’AFA développe depuis des années. Elle évoque notamment une étude réalisée avec l’Institut Montaigne sur les critères de qualité ressentis par les personnes atteintes de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. « On a demandé aux patients ce qui comptait le plus dans leur prise en charge. On a vite compris que ce n’était pas seulement la réduction des symptômes ou les scores inflammatoires. Parmi les éléments les plus souvent cités : la gestion de la fatigue, les difficultés alimentaires, ou encore le sentiment de pouvoir vivre normalement. Des critères concrets, souvent absents des outils d’évaluation médicale ».
Observer, écouter, comprendre : l’expérience vécue au cœur de la recherche
Pour faire émerger ces données qualitatives, l’AFA s’appuie sur une méthodologie rigoureuse via « le consensus coopératif avec un groupe de patients ». Selon Anne Buisson, interroger les patients à travers des questionnaires classiques limite la portée des résultats : « Dès qu’on structure les réponses, on est déjà dans l’intervention. On filtre leur vécu. Nous plaidons pour des démarches plus immersives : observation, focus groupes, discussions ouvertes. Ce qui importe, c’est ce qui surgit dans les échanges entre patients. C’est là que l’on capte les vrais critères de qualité de vie. »
« Aider les patients à retrouver leur liberté. Leur permettre de vivre, pleinement, malgré la maladie. »
Un dialogue difficile entre médecine conventionnelle et attentes des malades
« Il existe un vrai décalage entre ce que les médecins jugent pertinent et ce que vivent les patients », regrette Anne Buisson. Elle cite un exemple marquant dans les MICI : « Pour les médecins, l’enjeu est de réduire l’inflammation. Mais pour certains patients, ce qui les empêche de vivre, c’est l’impériosité des diarrhées. Ce n’est pas quantifié aujourd’hui. » Ce constat s’étend aussi à la dimension psychologique : « Un expert a récemment indiqué lors d’un congrès qu’il venait de découvrir l’impact psychologique des MICI. C’est une illustration saisissante de la distance encore immense entre les avancées scientifiques et la réalité du quotidien ».
Convaincre le monde médical : rigueur scientifique et formation narrative
Pour que les choses changent, Anne Buisson identifie deux leviers : la production de données robustes et la formation des professionnels. « Pour parler aux médecins, il faut parler leur langue. Nous publions, nous présentons des abstracts dans des congrès, nous associons toujours des médecins à nos études. » Elle souligne également l’importance croissante de la médecine narrative. « On a formé des médecins à l’écoute du récit. Et on a vu leur regard évoluer. Ça change leur manière de consulter, de poser les questions, d’accompagner. »
Anne Buisson insiste sur la complémentarité du rôle des associations dans le système de santé : « Nous sommes là pour faire remonter les besoins, pour innover, pour accompagner là où le système ne va pas. » Elle cite le programme MICI-PASS, qui accompagne les jeunes lors du passage de la pédiatrie à des unités de soin adulte, ou les ateliers à distance proposés aux malades : gestion du stress, activité physique adaptée, alimentation. « Tout cela crée de la valeur. De la vraie valeur. »
Une médecine plus humaine, un futur plus libre
Anne Buisson conclut avec une vision ambitieuse mais nécessaire : « La Value-Based Healthcare ne peut pas se limiter à l’épisode de crise. Elle doit viser à accompagner les patients tout au long de leur vie. » Ainsi, elle appelle à reconnaître la prévention tertiaire comme une priorité de santé publique : « Donner des clés pour comprendre, agir, éviter les rechutes. C’est aussi cela, la valeur des soins. Et cela commence par l’accès à une information fiable, humaine, incarnée. » Pour Anne Buisson, tout converge vers un même objectif : « Aider les patients à retrouver leur liberté. Leur permettre de vivre, pleinement, malgré la maladie. » Une phrase simple, qui résume un combat : transformer un système centré sur la technique en une médecine véritablement centrée sur la personne.
L’engagement des associations de patients telle que l’AFA démontre que la transformation ne viendra pas uniquement des institutions, mais aussi de la société civile, des patients eux-mêmes et des professionnels prêts à changer de prisme dans leur pratique quotidienne.
La reconnaissance du vécu, de l’expérience, du récit, constitue une avancée majeure pour penser une médecine plus juste, plus efficiente, et surtout plus humaine. Cela interroge notre manière de produire des soins, de penser la performance, de valoriser l’expertise profane. Et si, demain, les indicateurs de réussite des politiques de santé étaient définis non seulement par les taux de survie ou de rémission, mais aussi par la capacité des personnes à vivre pleinement leur vie malgré la maladie ?