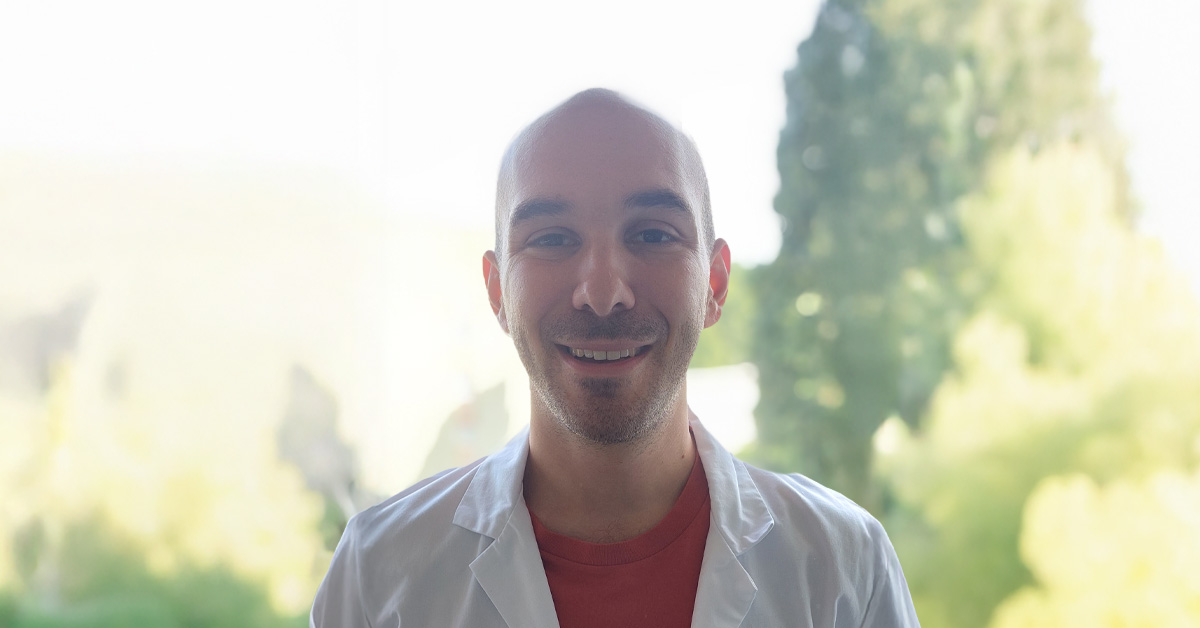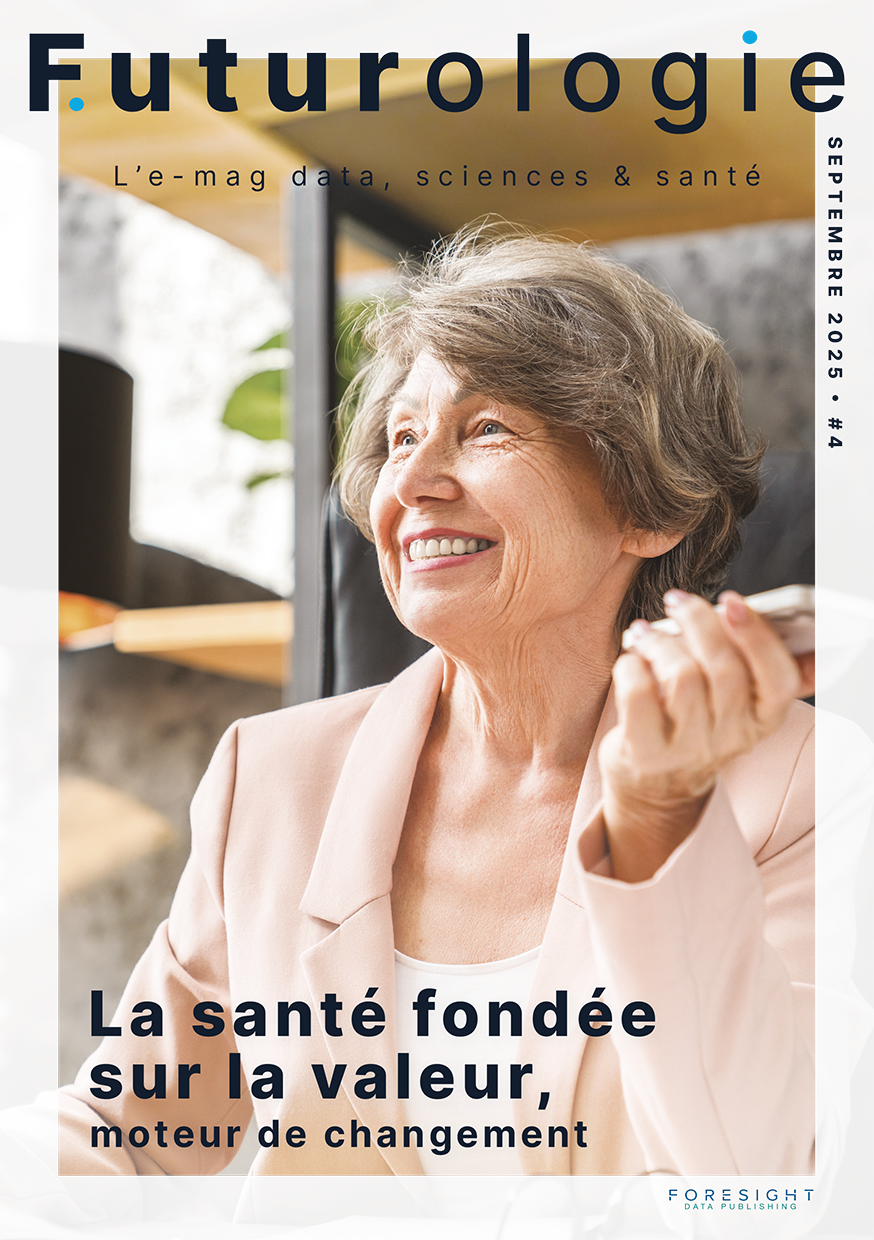Dr Quentin Ravier, pharmacien hospitalier à Mulhouse, met en lumière les mutations profondes du rôle pharmaceutique à l’hôpital. À travers une vision opérationnelle et critique de sa pratique, il souligne les enjeux structurels, logistiques et éthiques qui conditionnent l’efficience du système de santé. Au croisement des innovations thérapeutiques, des contraintes budgétaires et du virage vers une médecine centrée sur la valeur, le pharmacien hospitalier apparaît comme un maillon clé, souvent discret, mais hautement stratégique à l’hôpital.
Décloisonner les missions traditionnelles
Loin de l’image figée du pharmacien cantonné à la logistique, Quentin Ravier incarne une fonction hybride, entre gestion, interface clinique et innovation. Son profil polyvalent – « gestion de stocks, médicaments hors AMM (autorisation de mise sur le marché), rétrocession, conseil aux patients » – illustre l’élargissement du spectre d’intervention du pharmacien hospitalier. Cette polyvalence traduit aussi une exigence d’adaptation permanente : « formation continue, maîtrise administrative, et capacité à traduire des exigences scientifiques en logiques organisationnelles concrètes », détaille Quentin Ravier.
Le pharmacien face à la logique de valeur
Alors que le Value-Based Healthcare devient un référentiel structurant, Quentin Ravier alerte sur un paradoxe : « Je suis étonné que ce sujet soit à la mode. Ça devrait être la normalité. » Dans une vision centrée sur le patient, la valeur n’est plus seulement thérapeutique : « elle devient relationnelle, expérientielle et pédagogique ». La mission du pharmacien s’étend donc vers la transmission d’un savoir utile au patient, comme en témoigne son engagement en éducation thérapeutique du patient (ETP) : « Plus le patient comprend, plus il est observant. » Cette posture traduit un recentrage sur l’empowerment et l’éducation à la santé, autant de leviers durables pour une médecine participative.
« Gérer 30 à 40 % du budget d’un hôpital impose une rigueur sans faille »
L’innovation thérapeutique comme enjeu organisationnel
L’innovation pharmaceutique ne se résume pas à l’introduction d’une molécule. « Elle implique la refonte de circuits entiers : coordination logistique, éducation à l’autoinjection, sécurisation de l’accès anticipé », explicite Quentin Ravier.
Le pharmacien se positionne alors comme chef d’orchestre invisible de l’innovation : « On a mis en place tout un circuit avec les médecins et le labo pour optimiser le parcours, et soulager les personnels soignants de première ligne. » Ce rôle de facilitateur structurel est d’autant plus stratégique qu’il conditionne l’adoption et la pérennité des innovations thérapeutiques.
La conciliation médicamenteuse : un outil de transformation
« Gérer 30 à 40 % du budget d’un hôpital impose une rigueur sans faille », souligne Quentin Ravier. « Entre contrôle des stocks, traçabilité des produits chers, et analyse des facturations, la PUI (pharmacie à usage intérieur) est au cœur de la soutenabilité financière des soins ».
Mais au-delà de l’optimisation comptable, le pharmacien agit en stratège du bon usage. L’exemple de la déprescription des IPP est parlant : « On a divisé par deux le budget IPP à Mulhouse. Une action guidée par la pertinence des soins et non par l’économie en soi ».
Obligatoire dans la certification HAS v2026, la conciliation médicamenteuse est révélatrice des tensions systémiques. Là où les CHU disposent d’internes et d’externes pour l’effectuer, les CH comme Mulhouse manquent de ressources humaines : « On n’a pas d’externe. » Cette disparité interroge l’égalité d’accès à une qualité pharmaceutique homogène sur le territoire. Elle soulève aussi la question d’un déploiement équitable des outils d’aide à la décision, notamment numériques.
Un plaidoyer pour l’éducation à la santé
Quentin Ravier ouvre un horizon plus vaste : « et si la transformation du système de santé devait commencer dès l’école ? On ne parle jamais de santé à l’école. » Derrière cette proposition se dessine un enjeu de société : permettre à chacun d’être acteur de sa santé, de comprendre les mécanismes du soin, et de décoder les usages du médicament. Un véritable chantier éducatif pour nourrir la légitimité du modèle basé sur la valeur.
À la fois technicien, clinicien et médiateur, le pharmacien hospitalier y apparaît comme un agent d’équilibre, garant de la cohérence entre innovation, soutenabilité et centration patient. Sa parole éclaire une facette souvent sous-estimée de l’hôpital : celle de l’intelligence organisationnelle discrète mais vitale.