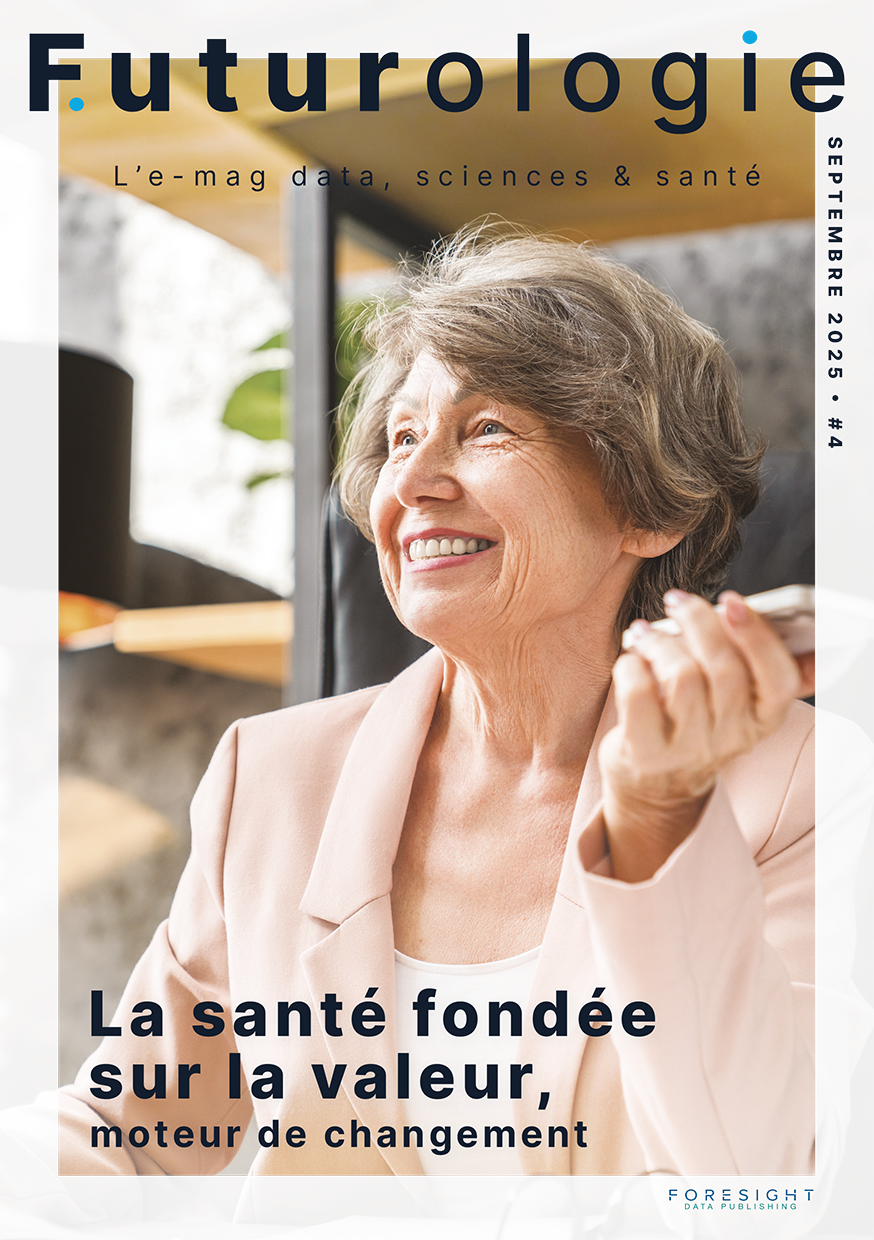Cardiologue de formation, ancien membre du collège de la Haute Autorité de Santé, Jean-François Thébaut incarne une voix expérimentée et engagée dans le domaine de la santé publique et de l’évaluation médico-économique. Il cumule les responsabilités : vice-président de la Fédération Française des Diabétiques, consultant en organisation et innovation en santé, et membre actif de plusieurs instances nationales comme le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie. À la croisée des mondes médical, institutionnel et associatif, il développe une analyse fine et critique du concept de « Value-Based Healthcare », ou la valeur en santé, en soulignant combien cette notion est tributaire du point de vue adopté.
Déconstruction d’un concept : la valeur selon les acteurs
Jean-François Thébaut déconstruit d’emblée l’idée d’une « valeur en santé » unique. Selon lui, les différentes parties prenantes — industriels, financeurs, professionnels de santé et patients — mobilisent ce terme à partir de logiques hétérogènes, voire incompatibles. « L’industriel raisonne en valeur revendiquée, l’assureur en coût évité, le professionnel en efficacité clinique, et le patient en qualité de vie » résume-t-il. Cette pluralité n’est pas anodine : elle produit des évaluations divergentes et des stratégies de santé souvent disjointes.
Ainsi, selon Jean-François Thébaut, la valeur d’un médicament est souvent traduite en termes tarifaires par les industriels. « Outre l’efficacité thérapeutique du produit, Ils tendent à revendiquer aussi des externalités positives ou négatives – effets organisationnels, retours au travail plus rapides, etc. – pour justifier leur position tarifaire. Mais cette approche fait fi de l’interdépendance des soins : diagnostic, suivi, coordination, tout ce qui précède et accompagne l’administration du médicament. » Le médicament n’est pas suffisant sans le système de soins », tranche Jean-François Thébaut.
Du côté de l’assurance maladie, la valeur est envisagée selon une logique de maîtrise des dépenses. « Le diabète, c’est 10 milliards d’euros en coûts directs, et 40 milliards si l’on ajoute les complications cardiovasculaires », explique Jean- François Thébaut. Le calcul ne se limite pas à la santé : les coûts sociaux comme les arrêts de travail devraient être aussi pris en compte.
Face à la complexité croissante des parcours, des modèles prédictifs comme les modèles de Markov sont mobilisées pour identifier les populations à haut risque, dans l’objectif de rationaliser la prescription.
Mais cette bascule conceptuelle vers la prévention ciblée reste à consolider. « L’assurance maladie n’a pas encore viré complètement de bord. Elle a peur que cela entraîne des dépenses supplémentaires », estime Jean-François Thébaut. « Des études européennes comme Itinérance ou Jacardi visent pourtant à individualiser le traitement des diabètes de type 1 et 2, à partir de profils cliniques et épidémiologiques ».
Loin d’être de simples bénéficiaires, les patients deviennent eux-mêmes promoteurs de la valeur. « Ce mouvement est né dans les années sida », rappelle Jean-François Thébaut, et « s’est consolidé à travers des crises sanitaires comme le sang contaminé ou l’affaire Mediator. Cette dynamique s’est traduite en France par la loi du 4 mars 2002 et l’émergence d’une démocratie sanitaire, mais centrée sur les hôpitaux ».
« Cette approche fait fi de l’interdépendance des soins : diagnostic, suivi, coordination, tout ce qui précède et accompagne l’administration du médicament. »
Rationalité économique, biais d’évaluation et marginalisation de l’expérience patient
Le modèle dominant d’évaluation médico-économique repose sur les QALYs (Quality Adjusted Life Years) et les RDCR (ratio différentiel coût résultat). Ce dernier permet de comparer un nouveau traitement à la prise en charge de référence. Mais Jean-François Thébaut en souligne les limites méthodologiques : « l’efficience dépend fortement de l’efficacité estimée, souvent surévaluée dans les cas de maladies rares ou de médicaments très innovants. Il cite l’exemple des dernières générations de traitements l’hépatite C, dont le coût individuel était élevé mais justifié par un RDCR très favorable en comparaison avec un traitement de référence peu efficace et onéreux ». Cependant, l’efficience économique ne garantit pas la soutenabilité budgétaire. « Le coût global dépend du nombre de patients éligibles. Un traitement peu coûteux mais largement diffusé peut avoir un impact budgétaire bien plus élevé qu’un traitement très cher mais rare » rappelle-t-il. Cette distinction est cruciale pour les politiques de remboursement.
L’expérience des patients reste marginalisée dans l’évaluation de la valeur. Les instruments utilisés, comme l’EQ5D, ne capturent pas la complexité vécue des maladies chroniques. Jean-François Thébaut évoque l’exemple du diabète de type 1, où les différences individuelles sont invisibilisées par un outil trop générique. Pour combler ce vide, la Fédération Française des Diabétiques a identifié et validé en français des questionnaires spécifiques, plus sensibles à l’impact du traitement sur le quotidien des patients. [1] [2] Il qualifie cette démarche de réponse à une injustice épistémique ou « l’incapacité des outils standards à reconnaître le savoir expérientiel des patients. Ces travaux nourrissent une redéfinition de la valeur fondée sur les données de vie réelle et les préférences individuelles — encore trop absentes des modèles actuels ».
Les associations entre plaidoyer et production de savoir
Au-delà du plaidoyer, certaines associations structurées et ayant des moyens financiers relatifs, telles que l’AFM Téléthon, Aides, AFA Crohn ou la Fédération Française des Diabétiques, produisent aussi de la connaissance utile à l’évaluation. « Notre Diabète LAB a contribué à faire évoluer les décisions de la HAS sur plusieurs dispositifs médicaux. Nos données ont permis de faire passer certains dispositifs d’un ASMR 4 ou 5 à un ASMR 3 », précise-t-il, citant le Freestyle d’Abbott ou la boucle semi-fermée Diabeloop. Cette capacité à documenter les usages et à influer sur les processus d’évaluation démontre l’émergence d’un nouveau rôle pour les associations : celui de producteur de preuves.
Jean-François Thébaut formule une critique sévère du processus d’innovation numérique en santé. Il dénonce l’absence de consultation des usagers en amont. « La plupart des applications sont conçues sans concertation avec les patients, et on nous demande ensuite de les évaluer ou d’en faire la promotion », déploret-il. Sans qu’aucune discussion préalable n’ait eu lieu sur les besoins d’interface, les formats de données, ou les usages attendus. Il y voit une « stratégie industrielle centrée sur la conformité administrative plutôt que sur l’amélioration réelle de la qualité de soin ou de l’expérience utilisateur ».
Vers une décision partagée fondée sur le sens
La décision médicale partagée constitue, pour Jean-François Thébaut, le cœur d’une approche fondée sur la valeur. Il cite le modèle du « High Value Care » qui repose sur quatre questions-clés structurantes à poser au patient [3] :
- Ai-je compris les bénéfices de ce qu’on me propose ?
- Quels sont les risques ?
- Quelles sont les alternatives ?
- Que se passe-t-il si je refuse ?
Ce cadre permet au patient d’exercer un choix éclairé, loin du paternalisme médical. Mais cette co-construction des décisions suppose un cadre linguistique (la fameuse littéracie en santé) adapté et un temps médical suffisant, deux conditions souvent non réunies. Il s’oppose également au discours gouvernemental sur la « responsabilisation » des patients, jugé culpabilisant et inadapté : « Nous ne sommes pas responsables de nos maladies. Nos prescriptions, ce sont les médecins qui les font. Notre seule responsabilité, c’est de prendre le traitement ou de changer de médecin. » Il alerte aussi sur le rôle du déni, cause d’une sous estimation des risques par les patients : « Quand on annonce une insuffisance cardiaque par exemple , les patients ne trouvent pas ça grave. Pourtant, c’est plus létal que bien des cancers. »
Jean-François Thébaut souligne également l’importance de la prévention quaternaire, un concept encore peu connu mais essentiel dans une approche centrée sur la valeur du point de vue des patients. Cette forme de prévention vise à éviter les dommages induits par les traitements eux-mêmes, en particulier lorsque leur bénéfice est incertain ou que les effets secondaires sont significatifs.
Il évoque notamment les traitements des cancers de la tête et du cou, dont « l’irradiation sauve des vies mais entraîne des handicaps majeurs. Sauver la vie ne doit pas se faire au prix d’un handicap sévère si des alternatives existent pour réduire les effets secondaires », plaide-t-il. Cette approche réintroduit la subjectivité et le vécu du patient comme critère central dans les choix thérapeutiques.
Penser la valeur non comme une donnée fixe, mais comme un processus collectif, pluridimensionnel et négocié, souligne la nécessité de dépasser les outils standardisés, d’intégrer les patients dans les logiques d’évaluation, et de construire des innovations cen- trées sur les usages réels. Le ‘Value-Based Healthcare’ ne pourra ainsi se concrétiser que par une approche réflexive, critique et inclusive de ses propres fondements.
[1] PRODIAB: Perspectives on the use of Patient-Reported Outcome Measures among diabetic patients – 11/01/23 Doi : 1016/j.deman.2023.100128 Nicolas Naïditch 1, Coline Hehn 1, 2, Amine Ounajim 3, Guy Fagherazzi 4, Antonia Gasch-Illescas 5, Ben Braithwaite 6, Jean-François Thébaut 1
[2] Development and validation of a Type 1 and Type 2 diabetes- patient-reported experience measure e-specific questionnaire: Diabetes reported experience measures (DREMS) – Coline Hehna,b,*, Amine Ounajimc, Guy Fagherazzid, Antonia Gasch-Illescase Guillaume Montaguf, Catherine Rumeau-Pichong,h, Jean-Arnaud Elissaldea, Ben Braithwaitei Herve Servyi, Charles Thivoletj, Jean-Francois Thebauta, Nicolas Naïditcha Diabetes Epidemiology and Management 13 (2024) 100189
[3] What Is Value in Health Care? Author: Michael Porter, Ph.D.Author Info & Affiliations Published December 23, 2010N Engl J Med 2010;363:2477-2481 DOI: 10.1056/ NEJMp1011024 VOL. 363 NO. 26