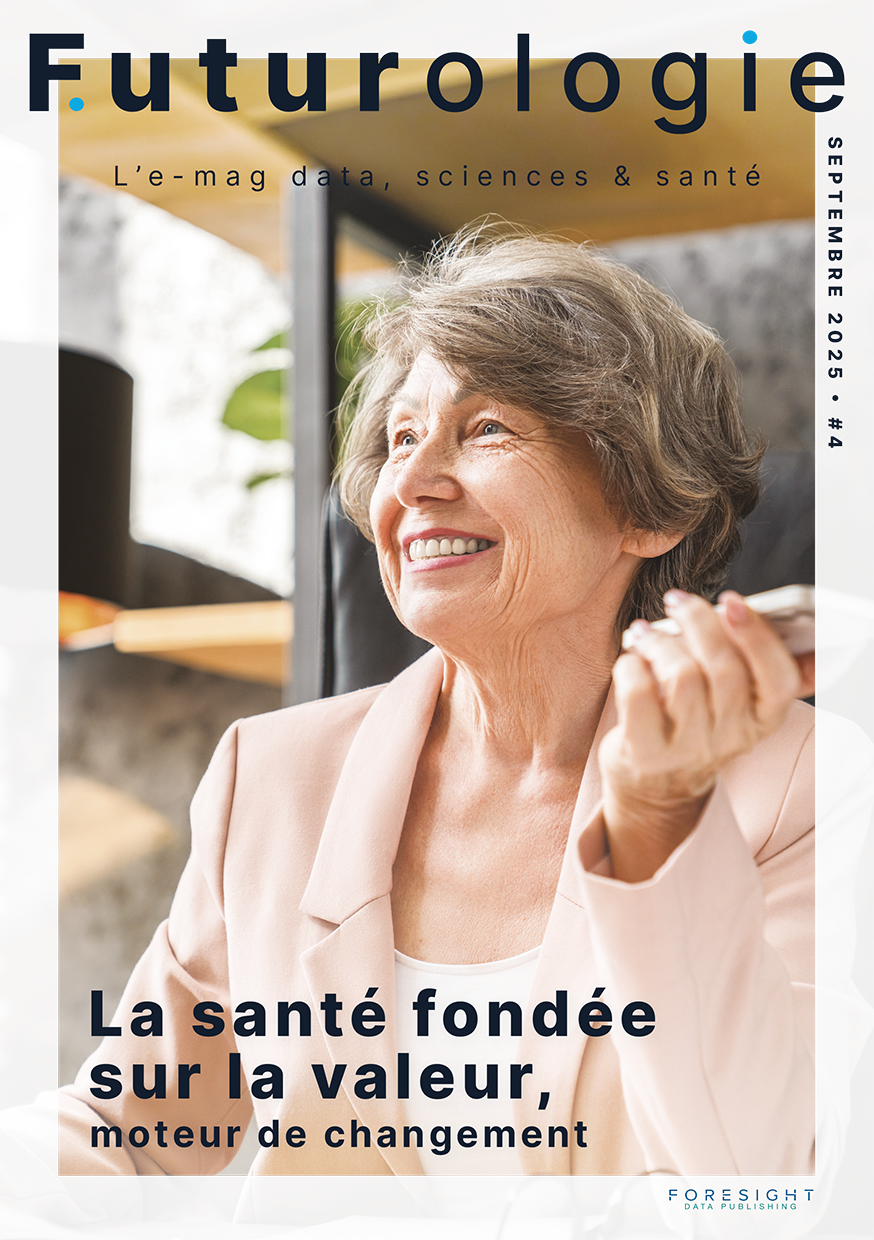Le parcours de Stéphanie Allassonnière, professeure de mathématiques appliquées à l’Université Paris Cité et intervenante à l’UFR de médecine, incarne un croisement rare entre rigueur mathématique et terrain médical. Elle révèle une trajectoire intellectuelle marquée à la fois par l’héritage familial – « Ma mère était infirmière puis surveillante aux urgences » — et par des rencontres déterminantes : « C’est surtout la rencontre avec mon directeur de master qui m’a fait découvrir l’application des mathématiques à la santé ».
Au fil de l’entretien, se dessine une posture de recherche ancrée dans l’interdisciplinarité, nourrie autant par des contraintes cliniques que par des intuitions théoriques. Stéphanie Allassonnière affirme une vision de la science comme outil de transformation du réel, mais aussi comme source d’élégance conceptuelle : « Parfois, c’est juste la beauté des mathématiques qui m’attire. »
Value-Based Healthcare : redondance ou évolution ?
Stéphanie Allassonnière porte un regard critique sur le concept de Value-Based Healthcare qu’elle questionne frontalement : « Je n’ai vraiment pas compris ce concept. À mon avis, la médecine est toujours Value-Based. L’efficacité est le cœur historique de l’acte médical, comme en atteste la logique des essais cliniques où la première chose que l’on regarde, c’est l’efficacité ». Cette vision soulève un débat sur la pertinence des mots nouveaux pour désigner des pratiques anciennes. L’analyse de son propos suggère que si le Value-Based Healthcare prétend réorienter la médecine vers la valeur pour le patient, « il ne peut le faire sans repenser profondément les modèles économiques de la santé ».
Quand la recherche naît de l’alliance entre empirisme et créativité théorique
Le projet Sonio incarne parfaitement l’articulation entre recherche académique et innovation clinique. « Sonio, c’est une suite logicielle qui permet plusieurs choses », explique-t-elle, détaillant un processus en plusieurs étapes : « contrôle qualité des examens échographiques, détection d’anomalies, optimisation du diagnostic, rédaction standardisée des comptes rendus ». L’intérêt est double : « homogénéiser les pratiques tout en recentrant les professionnels sur des tâches à haute valeur ajoutée ». Elle insiste : « On ne fait pas gagner du temps, mais on fait gagner en qualité chaque examen. » Cette logique de standardisation par le haut répond à une « inégalité structurelle dans l’interprétation des images fœtales, selon le niveau d’expérience des praticiens ». Stéphanie Allassonnière nous révèle un mode de production de la recherche à double entrée : « des projets émergent à la fois des besoins exprimés par les médecins et d’intuitions mathématiques plus spéculatives ». Elle raconte avec humour avoir proposé une idée « complètement farfelue » à un doctorant, qui finalement s’est avérée féconde dans le domaine des patients artificiels. Cette complémentarité souligne un équilibre précieux entre ancrage empirique et créativité théorique. Elle rappelle que les grandes percées peuvent naître de l’esthétique d’un modèle : « Des choses qui s’arrangent bien, qui éclairent d’un seul coup. De jolies maths ».
« Parfois, c’est juste la beauté des mathématiques qui m’attire »
La santé comme enjeu sociétal : vers un nouveau paradigme
Au-delà de la technique, Stéphanie Allassonnière porte une vision politique de la santé. Elle critique la logique actuelle du système de soins fondée sur la rémunération à l’acte : « On ne valorise que l’acte de maladie, et ça, ça ne va pas. Le paradigme de santé se doit d’être centré sur la prévention, l’anticipation et l’éducation ». Elle illustre cette ambition dès l’école primaire, citant l’importance des habitudes alimentaires, de l’activité physique et de la conscience environnementale. « Il faut des professionnels de la santé, pas du soin, qui viennent dans les écoles. »
Cette pensée s’étend aux patients comorbides ou âgés : elle imagine des kinés et des IPA impliqués non pas seulement dans la rééducation, mais dans l’anticipation de la perte d’autonomie. « Aujourd’hui, on est dans la réaction. Il faut aller vers l’anticipation. » Le système économique est ici l’obstacle majeur à ses yeux. Stéphanie Allassonnière nous invite à revoir les fondements de notre système de santé : « On a un ministère de la Santé, allons jusqu’au bout du paradigme. »
Faire société avec la science : un défi de communication
La question du lien entre science et société amène à un constat sévère : « Il y a un manque de confiance manifeste dans la science. » Stéphanie Allassonnière en appelle à une « médiation active, ancrée dans les médias et les territoires », citant l’exemple de l’Université de Genève où les scientifiques prennent la parole régulièrement dans les médias grand public, et regrette que les universités françaises soient trop peu impliquées dans leur environnement local. Elle identifie la télévision publique comme un levier encore sous-exploité. Sa vision d’une « science accessible, mais avec modestie » résonne comme un appel à réinventer le dialogue entre recherche, citoyens et décideurs.
Des mathématiques au service d’une médecine humaniste
Stéphanie Allassonnière incarne une posture singulière dans le champ académique : une chercheuse qui conjugue exigence scientifique, engagement social et pensée systémique. De Sonio à la prévention, de la géométrie riemannienne aux parcours de soin, son itinéraire démontre que les mathématiques ne sont pas réservées à l’abstraction, mais peuvent irriguer profondément les transformations de la médecine.
Stéphanie Allassonnière est une figure singulière dans le paysage de la recherche française. Elle incarne cette génération de scientifiques qui investissent les frontières disciplinaires pour transformer la pratique médicale. Formée à l’abstraction et à la rigueur mathématique, elle a su orienter ses recherches vers des enjeux concrets de santé, en mettant notamment son expertise au service de projets tels que l’intelligence artificielle en échographie, la génération de patients artificiels ou l’optimisation des essais cliniques.